
Les journaux officiels et journaux d’opinion qui connaissent un développement notable à partir des années 1910 proposent à leurs lecteurs en fin ou début de chaque livraison des extraits d’œuvres littéraires européennes, de relations de voyage et d’exploration dans les colonies et en Guyane, notamment, voire ces créations littéraires locales.
Nouvelles, poèmes, chansons, romans investissent régulièrement, dans La Guyane ou La Voix du Peuple, une rubrique littéraire qui ne porte pas encore toujours son nom.
L’une de ces œuvres, écrite par un certain « Carby Pope », s’intitule Mont-Sinéry. Le début du roman est publié dans trois numéros de La Voix du Peuple de mars 1936. Nous n’en connaissons pas la suite. A vous de l’écrire !
Mont-Sinéry
Roman
par Carby Pope
Chapitre I
Voyage
C’était l’aube, et un dimanche. Un vent d’une humidité pénétrante glaçait les poumons. Au bout du pont, une chaloupe, sur le point d’appareiller, drapeau tricolore dressé à l’arrière, se balançait lentement. Deux hommes s’y trouvaient, montrant une très grande impatience.
Soudain l’un au teint brûlé, un beau fils de la Bretagne, crie :
« Allons Mède, embarque ! Faut s’dépêcher ! ».
Mède, un grand jeune homme de seize à dix-huit ans, vêtu de kaki, descend prestement les marches du pont et le bras de Tovic qui l’avait appelé le reçoit sans fléchir.
– J’ai rencontré Luc et…
– Qui est Luc ?
– Luc, mon cousin !
– Ah oui ! Alors ? dit Tovic, commençant la manœuvre. Obligé d’élever la voix à cause des ronronnements du moteur, Mède reprit :
« Eh bien, il m’a retenu avec une de ses histoires habituelles, sans tête ni queue. Bien entendu, je ne puis t’en rapporter un brin. Je lui dois ce retard. »
– Excuse-moi d’avoir pensé que… tu flirtais, dit Tovic, riant.
– Tu exagères, vieux, de si grand matin !
Tovic se contenta de cligner malicieusement. Puis, inconscient souci de marin, il porta son regard vers le ciel où des nuages se déplaçaient imperceptiblement. La chaloupe piquait droit vers la pointe Macouria.
On voyait au-delà du fleuve les lumières de Cayenne jaillir, se multiplier, consteller le jour naissant, puis commencer d’agoniser avant de mourir jusqu’à l’heure vespérale de la résurrection.
Des bâtisses se sont dressées au pied du mont Cépérou, fort de résistance des anciens assiégés, aujourd’hui inoffensive élévation, lieu de promenade d’où l’on a une magnifique vue de la petite capitale, située et édifiée si merveilleusement. La caserne, seule, ajoute une note brutale et ses murs jaunes, percés de nombreuses fenêtres grandes ouvertes, semblent des damiers géants. Bâtisses, mont, tout disparaissait peu à peu au bout de la haute bordure vert bleu de palétuviers.
Cette bordure s’étend sans interruption jusqu’aux maisons du Larivot puis reprend sur une longueur que limitent les cieux.
Le rivage de Macouria courait à droite.
Passés bien vite les barrages de pêcheurs, barrages qui attirent les goélands, innombrables nonchalants, piquant soudain dans les flots, puis reprenant leur vol infatigable ; passés les cadavres des vaisseaux, le phare du Cheval-Blanc, le Larivot.
Mède, qui s’était laissé aller à la rêverie, s’éveille et s’étonne de voir s’enfuir derrière eux la pointe Macouria, voisine du Larivot.
« Nom d’une tomate ! Tovic, pourquoi ne m’as-tu rien dit ; je voulais visiter la pointe ! »
– Allons ! Rien n’est perdu ! Ce sera pour le retour.
La proposition ne l’enchanta pas ; il ne répondit rien.
Les flots deviennent de moins en moins fréquents, puis c’est la rivière calme et magnifique ! La chaloupe glisse comme sur une épaisse couche d’huile, elle déchire ce miroir dans lequel se mirent les cieux gris, puis laisse des deux côtés de ses flancs s’épanouir de larges ondulations.
Tout ému à la vue de ce spectacle enchanteur, chacun ne peut que murmurer lentement, embrassant des yeux la longue rivière qui coule silencieuse dans sa majesté magnifique : Qu’elle est belle…!
Tovic se ressaisit :
« Oui, elle est belle. Elles sont belles les rivières de ton pays. Chez moi, en Bretagne, où l’on trouve les sites parmi les plus beaux de France, je n’ai rien vu de tel. Il y a des rivières étroites, peu majestueuses. Mais heureusement les vertes prairies qui les bordent, vastes pâturages, sont plus jolies que ces bordures de palétuviers.
« Pourtant, j’aime de regarder ces arbres imputrescibles. Leur beauté mystérieuse, décourageante pour qui veut violer leur secret, a bien souvent réveillé en moi je ne sais quelles idées… de misère, de faiblesse. »
Quelle reconnaissante expression s’est alors aventurée par les traits, les yeux de Mède, où domina déjà une légitime fierté.
Rare franchise !!! Et cependant… mon pays… beau, magnifique… splendide !
Il murmure, il sourit.
L’ardent amour de sa Guyane se réveille ; Mède pense que les dilettantes d’absurdités ne peuvent sans être accusés de corruption, « d’hommes-désastres », barbouiller cette nature guyanaise, si chef-d’oeuvrale création ; une sorte de diplopie causée par l’envie de se « championniser » les contraint hélas à multiplier follement les caractères disgracieux, odieux qu’ils lui attribuent…
O victima, le souvenir de ces dilacérations que muette tu supportes soulèvent dans le cœur de ceux que tes entrailles fécondes nourrissent l’amertume, même la haine insurrectionnelle…! Et cependant !
Pourquoi Mède continue-t-il de sourire, d’un sourire candide, héroïque, en vérité, quand les pensées sont ainsi infectées ? Pourquoi ? Tovic, dis-le, toi que Mède appelle loyal, toi qui dis ce que tu vois et penses ce que tu dis !
Une lutte d’idées se livre en l’esprit du Breton, qui sait qu’il vient de réveiller de bien tristes souvenirs auprès de lui… en Mède, en Paul, l’aide-mécanicien, dont les yeux sont fixés sur la rivière par où il doit conduire la chaloupe et dont les pensées gravitent autour de la lanternerie qui dépare sa patrie.
Tovic regarde Mède, puis le cours d’eau, puis les palétuviers obsédants… Il confronte l’enfant, l’eau et les arbres pour découvrir ce que… quoi ? Il ne sait pas… ce sourire ?
Tout… est… donc… mystérieux… en Guyane !!! Cette idée tourbillonne, le tourmente, le domine. Elle est sa maîtresse puissante et elle s’échappe en une parole lente, scandée… car elle est troublante.
– Non, Tovic, tout n’est pas mystérieux, tout est beau.
La réplique est partie avec la même lenteur, mais avec, de plus, le charme, la certitude… et toujours le sourire de mépris ? D’amour passionné ?
Le silence l’a suivie, puis elle a repris, exaltée, bruyante, écrasante.
– Tout est beau. La beauté est tout. Mon pays est tout.
« Toi Tovic, fils de l’Europe qui s’appelle civilisatrice, congénère des hommes au pouvoir si merveilleux, regarde cette rivière. Souviens-toi de celles de ton pays. Qu’en ont-ils fait ? Ils l’ont détournée de sa fin pour satisfaire la leur. Leur fin est-elle donc plus précieuse ? Ils l’ont souillée de sang, de celui des milliers d’autres, de celui de mes pères. Bientôt encore ils me raviront la vie. Pourquoi ? Le sais-tu ? Pour réaliser un idéal, mal compris, sinistre. Et en retour, ah, Tovic, en retour, ils accablent ma patrie que n’a corrompue nulle souillure, que n’a troublée nul fracas imbécile ! La nature même ne s’y met jamais en colère frénétique. Rien que la pureté, la naïveté peut-être, ô intelligente naïveté ! ô félicité ! Audacieux, stupides, arrêtez-vous ; mon pays, laissez-le, mon pays, mon doux pays ! ».
L’hymne tantôt furieux tantôt tranquille finit sur note haletante qui, s’enfant de douceur, fait descendre Mède de l’intermonde où il s’était lancé.
Avec la brise ont fui les enthousiastes paroles concrétisées par des gestes, tout à tour délatrices et glorificatrices.
Maintenant encore elles vibrent dans l’éther, ce monde de choses divines. Elles flottent autour des palétuviers, dessus la rivière. Elles protègent, invisible mais puissante, cette nature que Mède a couverte de lauriers.
Le soleil qui, au départ, avait paru céder aux lentes attaques des nuages, a vaincu.
La rivière est un long joyau liquescent, d’or, d’argent, d’opale, de diamant, de saphir, de topaze… Ouf ! Ouf ! Elle éblouit, elle veut aveugler qui ne s’incline pas devant sa prestigieuse réalité, attiser l’ardeur de qui la chante.
Paul déteste la monotonie des bruits continus du moteur. Après la sympathique exaltation de Mède, elle est un vide où il s’est senti soudain tomber. Et vite il attrape un air involontairement remémoré qui allait glisser et s’enfuir. Il lui retrouve avec la même rapidité les paroles musicales en elles-mêmes. Il chante à tue-tête la fameuse création du mordant Nibul, défilé parfumé, succulent, précieux.
La Guyane ça oun’ joli jardin
Ti gain féy’ qué fleur ka senti bon
……..
La Guyan’ gain bel fruit pou dessé
……..
Sapoti, zoranj’ qué pomm’ cythè
……..
La Guyan’ gain toutt’ façon pied bois
Bois serpent, wapa qué wacapou
……..
C’est un air de valse-gragé, un air de danse locale. Le rythme en est pareil à celui des valses européennes. Seuls les pas diffèrent et le maintien du corps. Ce ne sont pas des pas à proprement parler. On se déplace peu, très peu. On imprime aux pieds des mouvements compliqués, difficiles, scandés bruyamment, s’harmonisant avec les gracieux balancements du corps. Les sourires ne manquent pas et eux aussi combien charmants.
Dans les campagnes où ce genre est fréquent, plusieurs tambours, instruments préférés pour les danses du pays, servent à la fois et quand ils parlent sous les mains des virtuoses, quiconque les entend, blanc ou noir, d’Europe ou de Guyane, se sent irrésistiblement entraîné par leur ensorceleuse cadence. Aussi, de quelle volupté sont saisis danseurs et danseuses !
Celles-ci, retenant de leurs mains les pans de leur jupe, s’oublient dans les longs délices, ne pensent même pas à ceux-là qui se dépensent éperdument dans cet exercice agréable.
On trouve exprimés dans le gragé et dans toutes les danses qui lui sont apparentées par l’origine tous les aspects de l’âme guyanaise, apte à l’enthousiasme, mais trop enfouie dans les langueurs d’une vie facile.
Le « la la la » du refrain avait réussi à desserrer les traits de Mède jusqu’à le faire sourire.
Paul avait inconsciemment fait œuvre de magicien, il avait par son chant arraché son jeune ami à l’exténuation, la prostration où l’avait plongé son ardent plaidoyer. La force magique étant de plus en plus puissante, Mède s’est rapprochée du chanteur. Il a posé une de ses fines mains sur l’épaule brune et suante qui lui était offerte. Il a écouté, il écoute encore la voix infatigable, affectionnée soudain d’une manière infinie, presque inexprimable pendant que son regard saisit le paysage.
Ce ne sont plus uniquement des palétuviers comme tout à l’heure, là-bas. Il y a aussi, parmi ces arbres que Tovic dit aimer, tantôt des cocotiers, des bananiers encore courts, premières plantations de la culture naissante, d’autres arbres fruitiers variés reconnaissables de loin par l’œil exercé, tantôt une chaumière au toit bruni, servant peut-être, comme celle tout près de laquelle la vedette est passée, d’abri à des sacs bondés de charbon, un petit espace qui n’a plus que des restes de troncs carbonisés, fumant encore et d’où émane une forte odeur de brûlé… l’odeur des abattis. Un ciel pur tâché parfois au fond de nuages pareils à des masses neigeuses, sérieuses égarées jusque dans ces parages tropicaux. Un soleil magnifique cruellement réfléchi par la rivière aux yeux obligés de se clore à moitié.
Ce spectacle n’a pas pénétré, cette fois, dans l’intime de Mède. Un courant de souvenirs s’y oppose, souvenirs qui le ramènent bien arrière dans le temps et l’espace.
– Ce que tu chantes, Paul, ce que tu chantes, ne l’ai-je pas entendu un soir de grand gala, dans la première salle de spectacles cayennaise ?
Cette question, il allait la poser quand il s’est rappelé que Paul ne pouvait pas le savoir à cause de… son humble bourse. Il s’est interrogé lui-même et il a revu l’effervescente assistance parmi laquelle bien des gens qui avaient courageusement fait face aux prix de l’entrée. Il y avait aussi ce soir-là de hautes personnalités venues respirer l’air de cette contrée américaine depuis trois cents ans française. Il y avait de l’enthousiasme, de la reconnaissance, de l’amour, brassés dans la salle.
Combien fûmes-nous ravis par les voix suaves des Grâces qui s’évertuaient, et l’on ne peut mieux, à refaire les pas du gragé appris la veille, car malheureusement les jeunes Cayennais ne connaissent pas cette danse ancestrale, si expressive (à suivre).






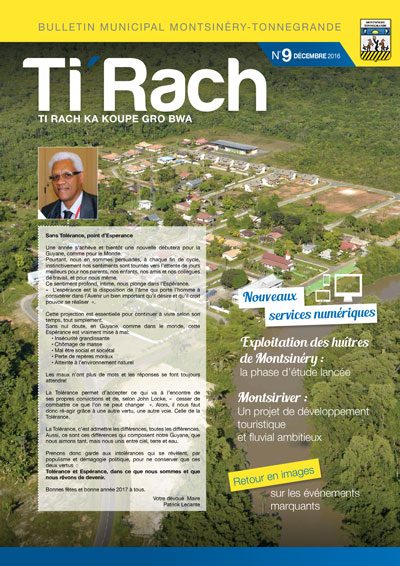
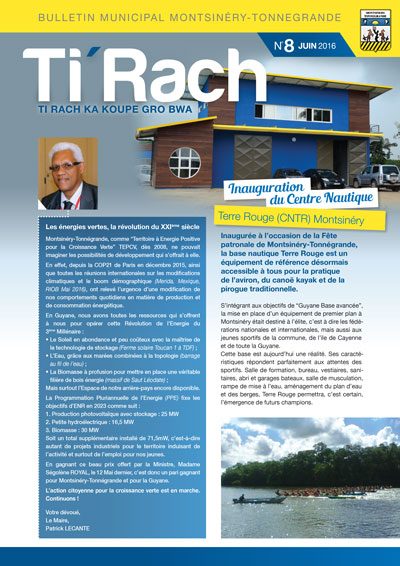


Commentaires